Face aux grands périls de notre siècle – changement climatique, terrorisme, pauvreté, trafics en tous genres –, les nations semblent paralysées. Les problèmes sont trop grands et trop interdépendants pour un État-nation devenu dysfonctionnel. Benjamin Barber, professeur de sciences politiques à l’université de New York montre dans son nouveau livre « Et si les maires gouvernaient le monde« , publié aux éditions de la rue de l’Echiquier, que les villes, et les maires qui en ont la charge, font un meilleur « job ». Car elles partagent à travers le monde les mêmes caractéristiques : le pragmatisme, la confiance des citoyens, l’indifférence aux frontières et à la souveraineté, ainsi qu’un goût pour le travail en réseau, la créativité, l’innovation et la coopération. S’appuyant sur l’expérience concrète et novatrice d’une douzaine de maires à travers le monde – de Gdansk à Los Angeles, de Mosc ou à Bogota, de Rome à Singapour –, cet ouvrage, dont nous présentons ici des extraits, présente une vision stimulante de ce que pourrait être la gouvernance locale au XXIe siècle.
Dans ce monde surpeuplé aux différences trop marquées et à la solidarité trop fragile, la démocratie traverse une profonde crise. Les États-nations ont, jadis, résolu les problèmes d’échelle dont souffrait la démocratie. Aujourd’hui,ils freinent sa mondialisation.Le moment est donc venu de se demander sérieusement : « Les villes peuvent-elles sauver le monde ? » Je pense que oui.
[Pour comprendre l’importance du sujet lire aussi Mille maires à Paris en décembre pour la conférence climat]
Les États résistent à toute collaboration transfrontalière. Notre principal défi politique est donc de découvrir ou de créer des institutions alternatives, capables de s’occuper des problèmes toujours plus nombreux de notre monde interdépendant, sans renoncer à la démocratie garantie par les États-nations. Afin de nous préserver tout à la fois des formes anarchiques que prend la mondialisation, telles que les guerres et le terrorisme, et de ses formes monopolistiques, comme les multinationales, nous avons besoin d’organismes démocratiques et internationaux efficaces, capables de relever les défis planétaires auxquels ce monde, de plus en plus construit en réseau, nous expose. Au cours des siècles, les conflits ont façonné notre univers. Mais, du congrès de Vienne à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme en passant par la défaite des puissances de l’Axe, et du traité de Versailles à la chute du mur de Berlin et à la fin du monde bipolaire, les États- nations sont loin d’avoir mis en place une gouvernance mondiale.Trop enclins par nature à la rivalité et à l’exclusion mutuelle, ils semblent peu disposés à coopérer et incapables d’établir des biens communs mondiaux. La démocratie est prisonnière de leur puissante étreinte : comment espérer une démocratisation de la mondialisation ou une mondialisation de la démocratie tant que ce progrès dépendra de nations souveraines rivales ? Que faut-il donc faire ?
La solution est là, sous nos yeux, évidente mais le plus souvent méconnue : les villes sont nos ensembles politiques les plus interconnectés. Organisées en réseaux, elles se définissent avant tout par la collaboration et le pragmatisme, par la créativité et par la pluralité culturelle. Laissons-les faire ce que les États ne peuvent pas faire. Laissons les maires gouverner le monde. Puisque, comme l’écrit Edward Glaeser, « la force qui émane de la collaboration humaine est au centre de la réussite de la civilisation et à l’origine de l’existence des villes », celles-ci peuvent et doivent à coup sûr gouverner à l’échelle mondiale.
C’est en fait déjà le cas. Les villes sont de plus en plus impliquées dans des réseaux qui font le tour du globe et qui ont trait à la culture, au commerce et à la communication. On peut aider ces réseaux, ainsi que les dispositifs coopératifs qui les sous-tendent, à réaliser de façon formelle ce qu’ils font d’ores et déjà de manière informelle : gouverner sur la base du consensus, en coopérant quand c’est nécessaire. Si les maires dirigeaient la planète, les 3,5 milliards et quelques d’individus (plus de la moitié de la population mon- diale) qui vivent en ville, et tous ceux, plus nombreux encore, qui peuplent les territoires périurbains, pourraient participer localement et coopérer globalement à travers une forme miraculeuse de « glocalité » civique, promesse de pragmatisme et non de politique, d’innovation et non d’idéologie, et de solutions en lieu et place de souveraineté.
Le défi auquel est confrontée la démocratie dans le monde moderne est le suivant : comment relier la participation, locale, au pouvoir, central ? Autrefois, c’était le rôle de l’État-nation. Aujourd’hui, celui-ci est devenu trop grand pour permettre l’existence d’une participation significative et trop petit pour prendre en charge un pouvoir mondial centralisé. En réaction à ce constat, le cosmopolitisme nous invite à imaginer des citoyens – au sens littéral d’individus habitant dans la cité – ancrés dans des environnements urbains, où la participation et la communauté sont possibles et s’étendent au-delà des frontières pour s’opposer au pouvoir central et le circonscrire. Ces deux notions s’allieraient pour superviser et réguler la mondialisation anarchique et les forces illégitimes qu’elle libère. Il y a presque cent ans, John Dewey se lançait en « quête de la communauté suprême », celle qui, au travers d’activités communes et de symboles puissants, pourrait relier les individus en un large public, organisé autour de la communication4. Ce faisant, John Dewey rompait le lien entre la gouvernance de l’État d’une part, et la démocratie d’autre part. Il insistait pour que cette dernière fût envisagée comme une forme d’association approfondie, incluant la famille, l’école, l’industrie et la religion. Il était convaincu que la démocratie dévoilerait tout son potentiel lorsqu’elle serait perçue « comme une communion libre et enrichissante » et que « l’enquête sociale libre serait devenue indissociable de l’art de la communication pleine et émouvante ».
Dans un monde régi par les villes, la communauté suprême que John Dewey appelle de ses vœux prendra une forme démocratique. Nul besoin de créer ex nihilo un nouvel organisme dédié à la gouvernance mondiale. Nul besoin non plus, pour ces villes en réseau, de recevoir une certification de la part des États-nations qu’elles supplanteront. Ce nouveau monde mettra l’accent, à l’instar des derniers chapitres de cet ouvrage, sur la citoyenneté ascendante, la société civile, une communauté d’individus bénévoles, volon- taires, par-delà les frontières, et non sur des prescriptions et des mandats exécutifs imposés par quelques dirigeants internationaux. On peut trouver outrecuidant l’ex-maire de NewYork, Michael Bloomberg, mais sa rhétorique– loin de celle de John Dewey, car réaliste – exprime tout le pouvoir du localisme municipal sur fond de monde interdépendant : « Avec la police de NewYork, je dispose de ma propre armée, et j’ai mon propre ministère des Affaires étrangères, n’en déplaise au Département d’État. » NewYork abrite « toutes sortes d’individus venus de tous les coins du monde avec tous types de problèmes ». Cela ne plaît pas à Washington ? « De toute façon, concède Michael Bloomberg, je n’écoute pas beaucoup ce qu’ils disent, à Washington. »
Il n’y a ici aucune vantardise. Les problèmes et les perspectives inhérents à la ville donnent du poids à ses affirmations. Car, comme le maire de New York le souligne, « la différence entre mon niveau de gouvernance et d’autres est qu’ici, l’action prend forme dans la cité ». Tandis qu’à l’heure actuelle, le gouvernement américain est « parfaitement incapable de faire quoi que ce soit[…], les maires de ce pays sont encore et toujours confrontés à la réalité ». Les présidents pontifient à coups de grands principes, les maires ont les mains dans le cambouis. Et ils font campagne pour le contrôle des armes : Michael Bloomberg a, par exemple, créé l’ONG Mayors Against Illegal Guns (« les maires contre les armes illégales »). Et ils luttent contre le réchauffement climatique, via, notamment, le réseau C40, qui regroupe 40 grandes villes. Ce mode de pensée constructif s’exprime à travers des organismes comme le Conseil international pour les initiatives écologiques locales (ICLEI), dont le rapport, diffusé à la suite de l’inutile conférence de l’ONU sur le climat à Durban fin 2011, faisait observer que « les admi- nistrations locales sont ce qu’il existe de plus concret en matière de lutte contre le changement climatique ». Le positionnement des villes à l’égard du changement climatique s’était précisé un an plus tôt, lorsque 207 d’entre elles avaient signé le pacte de Mexico, à l’occasion du Sommet mondial des maires sur le climat, qui s’était tenu dans cette ville. Au même moment, les États s’engageaient vaguement à honorer les « stratégies et actions destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre ».
En développant et en diversifiant les réseaux grâce auxquels elles coopèrent déjà, les villes montrent qu’elles peuvent, ensemble, accomplir des choses dont les États sont incapables. […]
Lorsque des maires comme Michael Bloomberg à NewYork prennent des mesures pour freiner le tabagisme ou lutter contre l’obésité infantile en rédui- sant les ventes de sodas dans des bouteilles et des gobelets géants,Washington ne peut qu’observer avec étonnement et désapprouver ou saluer l’initiative. Et le gouvernement américain ne peut rien contre d’autres maires, ailleurs dans le monde, qui feraient de même – bien sûr, les tribunaux peuvent intervenir, comme ils l’ont fait en rejetant l’interdiction de Michael Bloomberg sur les boissons sucrées. Grâce à leurs lobbys arrogants et à leurs comptes en banque séduisants,les fabricants de sodas ou de cigarettes ont beaucoup d’influence sur les administrations centrales. Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose contre ces initiatives municipales, sinon déplorer, dans leurs campagnes publicitaires, la suppression du droit à se tuer (ou à tuer ses enfants). Je ne veux pas dire par là que les États n’ont aucun pouvoir de contrôle, ni même de strangulation, sur les villes qui tentent de leur échapper. Leur souveraineté législative et leur position de force en matière budgétaire leur offrent toutes sortes de moyens de stopper les villes débridées. D’ailleurs, la seule ville mondiale qui coexiste en bonne intelligence au côté de son État est Singapour, l’État et la ville ne faisant qu’un. Un éventail étonnamment large d’activités et de coopérations transfrontalières reste cependant accessible aux villes qui le souhaitent vraiment.
Cet appel, que je lance pour que les maires gouvernent le monde et permettent à leurs administrés urbains de sortir de leur pays et de devenir des citoyens sans frontières, n’est donc pas utopique. Ce n’est pas un simple souhait en faveur d’un impossible régime fondé sur la justice mondiale. De quoi cet appel a-t-il besoin pour se concrétiser ? De la reconnaissance d’un processus déjà en cours, celui d’un monde qui se forme en l’absence de planification systémique et sans la bénédiction d’une quelconque autorité étatique. Et de notre désir d’utiliser le potentiel, unique, de l’urbanité : une coopération et un égalitarisme libérés de la souveraineté et de la nationalité, de l’idéologie et de l’inégalité, bref, de ces forces obstinées qui isolent les États-nations dans des forteresses soi-disant garantes de notre indépendance et de notre autonomie. Les maires, désireux de coopérer les uns avec les autres, n’ont aucune raison de céder aux sirènes de Nations présumées unies… et qui ne le seront, en vérité, jamais, car elles réunissent des pays rivaux, obsédés par leur souveraineté et leur indépendance. […]
Revenons au point de départ : les villes peuvent-elles sauver le monde ? Le défi est sans doute trop grand. Mais elles peuvent vraisemblablement sauver la démocratie du péril de la souveraineté et trouver des moyens de gouverner la planète de façon démocratique et descendante – du haut vers le bas – ou, à tout le moins, informelle, bref, des moyens efficaces, pragmatiques, libérés de toute idéologie. L’ancien président Bill Clinton a rappelé, lors de la convention démocrate de 2012, que « lorsque les temps sont durs et que les gens sont malheureux, en colère, qu’ils souffrent et qu’ils sont déstabilisés, la politique de l’opposition systématique peut sembler bonne. Mais, en réalité, ce qu’on appelle une bonne politique ne fonctionne pas nécessairement. Ce qui marche, c’est la coopération ». Puis il s’est tourné vers le cœur même de la ville et, au milieu des vivats et des applaudissements, il a exhorté les personnes présentes à « s’adresser aux maires qui sont ici. Los Angeles se met au vert et Chicago se dote d’une banque spécialisée dans les infrastructures, parce que républicains et démocrates y travaillent de concert et mettent leurs neurones à contribution. Leurs désaccords n’ont pas disparu pour autant, mais leur objectif est d’obtenir des résultats concrets ».
Ce que je veux, moi aussi, avec ce livre, c’est obtenir des résultats concrets. Que l’on change de sujet : que l’on passe des États aux villes, de l’indépendance à l’interdépendance et de l’idéologie à la résolution des problèmes. La ville est aujourd’hui le sujet qui s’impose : l’espoir y a toujours été monnaie courante, et les maires ont toujours fait preuve d’optimisme. « Le contraste est saisissant entre l’optimisme des commentateurs urbains et le pessimisme de ceux qui restent attachés aux pays et aux institutions multinationales », fait observer le blogueur urbain Matthew Taylor.
Benjamin Barber
« Et si les maires gouvernaient le monde« , éditions de la rue de l’Echiquier, 2015.
Les autres livres des éditions de la rue de l’Echiquier

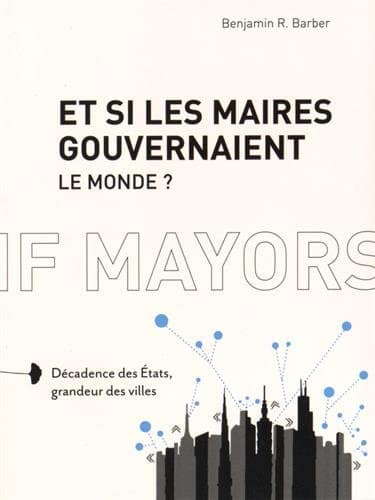
2 commentaires
Ecrire un commentaire
Moâ
Ce livre m’a l’air intéressant. L’idée qu’il véhicule aussi. Elle est réaliste. Il est clair que les maires ont beaucoup plus le sens des réalités que des chefs d’état et ministres qui conduisent pourtant de belles voitures (le pays) sans savoir réellement comment fonctionne le moteur (la société et les citoyens) et qui les font entretenir par des truands (« lobbys arrogants » comme cité ci-dessus, multinationales sans scrupules, financiers cupides, experts illusionnistes). Pas étonnant qu’au bout d’un moment, tout tombe en panne !
Bonnet
Je pense aussi que c’est une idée intéressante dans la mesure où les maires sont plus proches de leurs administrés, donc plus proches du terrain pour comprendre les préoccupations de leurs administrés et il est certainement plus « facile » de prendre une décision au niveau local qu’au niveau national tout englués que sont nos politiques dans leur obsession de se maintenir au pouvoir.
Certaines municipalités ont réussi à mettre en place des communautés de communes pour rationaliser les coûts de fonctionnement etc…, il semble donc possible à ce niveau d’aller plus loin sur différentes questions notamment environnementales. Je pense même qu’une certaine émulation sur la population devrait inciter les maires à prendre en mains certains changements et les pousser à coopérer entre eux.